Enfin, un Pierre Benoit à mon goût !

Verticale d’Henri Lhéritier (suite)
Voilà ! Il fallait bien qu’un jour j’en trouve un à mon goût. La moitié d’un. Pas facile, quand même. J’ai dû arriver à la page 99 de mon exemplaire Albin Michel de Cavalier 6 et l’Oublié de Pierre Benoit, paru pour la première fois en 1922 et mis sous presse en 1933.
Jusqu’à maintenant je comparais l’œuvre de Pierre Benoit à ces boites de mauvais bonbons au chocolat offertes à Noël dans un emballage rutilant. En tendant la main pour en saisir un, on fait à chaque fois la même prière : Mon Dieu, faites qu’un jour, j’en aime un. Jamais, cela n’arrive jamais. Sous la matière noirâtre est toujours fourré quelque chose d’innommable qui dégouline ou colle au palais.
Pourtant là, ça y est, je suis tombé sur du mangeable.
De nombreux auteurs de la première partie du XXème siècle ont disparu dans l’ombre de Proust et Céline. Ne reste souvent d’eux que la peau : le jaune du papier, le toucher soyeux et l’odeur de vieux livre. Pierre Benoit est de ceux-là, il surnage parfois.
Cette édition (41ème mille) comporte deux petits romans d’égale importance (cent pages chacun) Cavalier 6 et l’Oublié et deux nouvelles La surprenante aventure du baron de Pradeyles et Une commission rogatoire.
Je déteste Cavalier 6

Je déteste Cavalier 6, archétype du roman de Benoit écrit pour les gogos. Sans doute le résultat d’un pari : Pierre Benoit a un coup dans le nez, il dîne dans une brasserie parisienne en compagnie de quelques amis. Dans la salle on l’a reconnu. Il est devenu célèbre, Königsmarck et l’Atlantide, succès immenses, lui sont montés à la tête. Il parle haut et fort. Je peux écrire sur tout, fait-il à la cantonade, proposez-moi n’importe quel sujet. Un escadron de cosaques, dit, hilare, un de ses voisins de table, qui lève en même temps une coupe de champagne, l’avale cul sec et jette le verre dans son dos, pourquoi pas un escadron de cosaques dans le Loir et Cher ? Banco ! répond Benoit.
Ainsi est né le regrettable Cavalier 6. D’une forfanterie. Pierrot cuisina ce brouet à l’aide d’ingrédients romanesques lyophilisés : une troupe de cirque, une fille (amazone indomptable, style partenaire pour soirée sado-maso) abandonnée par son père, dix-huit ans auparavant, une mère morte en couches, un duc plein de morgue et pelé comme un rat, un nouveau riche dur en affaires fondant devant sa fille adoptive, bref l’outillage classique d’un romancier professionnel, l’escadron de cosaques évoluant dans ce salmigondis avec autant de naturel qu’une banane dans une soupe de légumes. Insupportable !
Un livre, même mauvais, reste plein de ressources. Il suffit de tourner une page et parfois on ressuscite.
Le génocide « oublié »
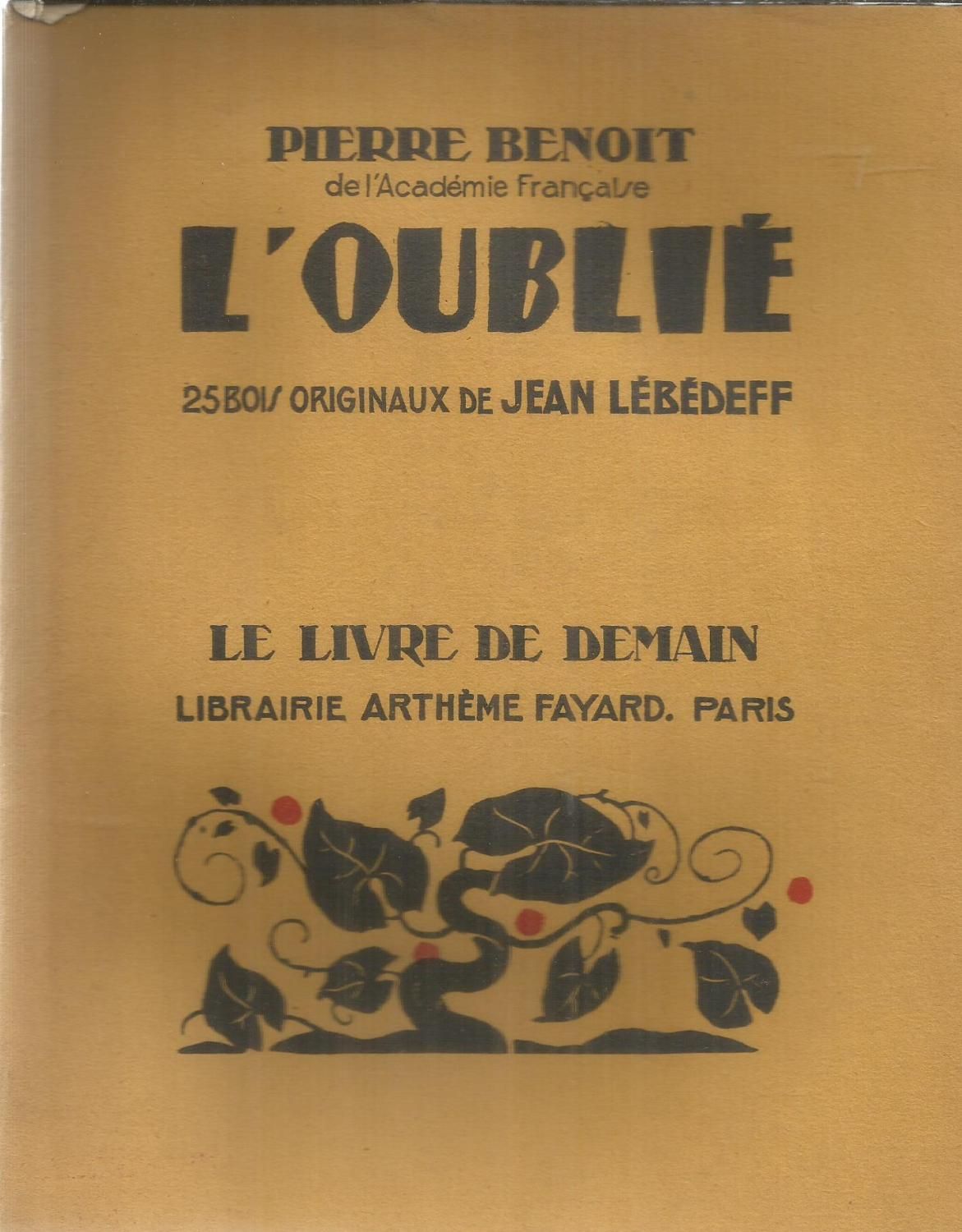
L’Oublié, le second texte du volume me réconcilie avec Benoit. En 1919, un escadron de cavaliers, français cette fois, (c’est un ouvrage hippique) est détaché de l’armée d’Orient, basée à Salonique, pour patrouiller aux confins de la Turquie et de l’Arménie car on a eu vent de massacres d’Arméniens par des Turcs.
Petite incidente : Pierre Benoit a inventé le révisionnisme avant la lettre. Il situe l’Oublié dans le cadre du génocide arménien (qu’on n’appelait pas encore ainsi à cette époque) pourtant il ne rencontre que des cadavres turcs. Je ne doute pas qu’il y ait eu aussi des massacres de Turcs, toutefois à cette époque-là et dans ces parages, il était plus périlleux d’être Arménien que Turc. D’accord, je ne suis pas historien. Pierre Benoit non plus. La droite extrême en France est affligée d’une grave maladie : les grands crimes de l’histoire ne sont pour elle que des détails, quand elle ne met pas en doute leur réalité même. Les massacres collatéraux lui apparaissent toujours plus douloureux. Bon, je vais passer là-dessus mais il fallait que je le dise.
L’escadron se paume dans la montagne, le sens de l’orientation n’est pas la première qualité des militaires, le héros, brigadier narrateur, part en reconnaissance en solitaire. Il découvre, au débouché d’une gorge vertigineuse, un paradis insoupçonné, sorte de royaume à la Tintin. La première rencontre avec les autorités de ce pays est désopilante : il tombe nez à nez avec des pique-niqueurs aristos. Ce qu’il avait pris pour des coups de fusil, n’est en fait que l’ouverture de nombreuses bouteilles de champagne et les convives de ce pique-nique, nappes blanches sur un pré au bord d’un lac, tenues d’été et canotiers, représentent le gratin de l’oligarchie locale. Du coup le héros se prétend colonel, on lui apprend qu’il vient de pénétrer en république d’Ossiplourie, que les hostilités entre la France et ce pays sont ouvertes, qu’il est donc prisonnier de guerre. Il va être utilisé comme un plénipotentiaire.
Pierre Benoit s’en donne à cœur joie dans la déconnante, lâche-toi, Pierrot, lâche-toi c’est comme ça que je t’aime. Je ne supporte pas l’exotisme caricatural de la plupart des romans d’aventure mais lorsqu’il se colore de distance, de dérision, de pastiche, je suis preneur, je bats la mesure comme si j’assistais à une opérette d’Offenbach. Je me prends même pour Agamemnon, le roi barbu qui s’avance,… bu qui s’avance,… bu qui s’avance. Moi, que voulez-vous, un pays perdu du Caucase où l’on joue du Paul Claudel au théâtre, où le meilleur restaurant de la capitale s’appelle Le saumon régénéré, où le bistro à la mode a pour enseigne Aux principes de 89 et où le commissaire aux marchés de guerre et à l’Instruction publique se nomme Azyme Electropoulos, ça m’enchante.

L’écrivain, coincé dans des histoires sérieuses à couleur locale d’Office du tourisme, qui oublie son fond de commerce pour faire tout à coup dans le burlesque, me ravit. L’Oublié est une suite rocambolesque d’enlèvements, de poursuites, de fuites, d’amourettes dans des décors de bandes dessinées et des costumes chamarrés sentant la naphtaline. À chaque porte qui s’ouvre, on a l’impression que vont surgir Marlène Dietrich ou Eric Von Stroheim.
Tout ici est aussi invraisemblable que dans les autres romans de Pierre Benoit, mais l’auteur ne cesse de nous faire des clins d’œil, on est complice, on marche.
En tout cas, moi j’ai marché. D’autant que le talent de conteur de Pierre Benoit et son art de soutenir l’intérêt sont toujours là. En lisant l’Oublié je me suis senti un enfant que l’on prend pour un adulte. Merci Pierrot.
Il me reste un doute : et si j’étais le seul à y déceler le pastiche ? Et si par hasard ce n’était pas du second degré. Tant pis après tout. Chaque roman appartient à son lecteur, mon Oublié était ainsi, je ne l’échangerai pas contre un autre.
La fin ? Assez conventionnelle, mais bon on sait bien que dans ce style de roman on n’aura pas droit au dénouement du Père Goriot ou d’Anna Karénine..
Reste que Benoit est indécrottable, il faut qu’il en rajoute une couche et qu’il plombe ses dernières lignes avec son négationnisme militant.
« En selle tout le monde, commanda notre chef sans faire plus attention à mon air navré. Et j’espère qu’à la fin de la journée, nous aurons bien fini par découvrir quelque Arménien massacré. Cela commence à devenir parfaitement ridicule ».
Il ne voit jamais ce qu’il faut voir Pierre Benoit. À la libération, il a été inquiété pour cette myopie-là. Pendant l’Occupation, il n’avait pas vu de victimes.
Allez 55/100, c’est bien payé pour un roman sur deux.
Henri Lhéritier

/image%2F0279781%2F201304%2Fob_516d4f42ac54bcb3a775f2df86d489cc_vl-2009-bon.jpg)