Embareck-Pobel : la flèche et la lance

Ils aiment les mots, ces deux-là. Les mots qui jouent, qui surprennent, qui mettent un nez rouge, qui tombent comme un cheveu sur la page, les mots qu’on détourne, qu’on fait chanter, qu’on invente, qu’on place comme une bombe dans le train-train d’une phrase. Aujourd’hui, on dégraisse, on va jusqu’à l’os, on coupe tout ce qui dépasse. On veut du plat, du sec, du creux. On fait dans l’allégé, le régime syntaxe, du pathos à 0%, du bateau ivre sans alcool. Ce n’est pas du tout leur style, à ces deux-là.
Ils se sont rencontrés aux Vendanges littéraires de Rivesaltes. L’un, frisé, gueule de baroudeur, y recevait en 2017 le prix Coup de foudre pour "Jim Morrison et le diable boiteux". L’autre, front lisse d’intello, faux air distrait d’un observateur-né, y était venu, comme chaque année, au nom d’une vieille amitié. Tous deux ont fait une belle carrière de journalistes. Michel Embareck, le frisé, écrivait notamment dans Best des articles sur la musique « noire » américaine. Didier Pobel était la « plume » éditoriale du Dauphiné Libéré. Le premier publiait des romans policiers, le second des recueils de poèmes. Leurs cibles littéraires n’ont fait que s’éloigner ces dernières années, l’un partant sur les traces de Jim Morrison, Johnny Cash et Bob Dylan, l’autre se partageant entre l’évocation de souvenirs (vrais ou imaginés) et des histoires pour la jeunesse. Mais l’amour des mots les rapproche. Et leurs derniers livres aussi. Où il est question de flèche et de lance.
***
« Une flèche dans la tête », de Michel Embareck
(113 pages, Joelle Losfeld éditions)
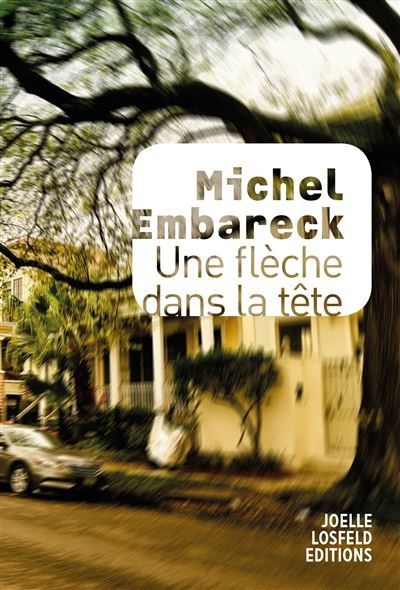
C’est un type « au corps plus vieux que son âge », rongé par une migraine, « sa plus fidèle maîtresse », qui lui donne l’impression d’avoir « un serpent, une aiguille à tricoter, un marteau piqueur ou une barre de fer dans la tête ». Ou encore une flèche. Une épave accrochée à son violon. C’est le violon qui intrigue sa fille. Ou plutôt l’étui à violon. Elle était une enfant quand le père avait quitté le domicile conjugal du côté des Buttes-Chaumont. Elle vit au Canada à présent. Et voilà qu’après tant d’années il la contacte pour lui proposer une sorte de voyage touristique sur la route du blues. Ils se retrouvent à l’aéroport de Memphis, sans savoir quoi se dire. Quand elle voit son père recevoir des mains d’un inconnu un étui à violon et une lettre qu’il lit et brûle, elle se dit que lui, l’ancien flic des renseignements généraux, a repris du service et qu’il l’entraîne dans une mission foireuse. Bien sûr, elle se trompe. Mais ils sont incapables de se parler tous deux. Il a cru qu’il pourrait renouer les liens qu’il avait brutalement rompus mais ça ne marche pas.
Au fil des étapes sur les lieux où le blues est né et a grandi, à la rencontre des « témoins » ou prétendus tels, de musées minables en tombes bidons, rien ne les rapproche. Il n’arrive pas à lui parler de Svetlana, l’amour de sa vie. Elle ne peut lui confier le drame qu’elle vient de vivre, violence et trahison. Alors, il lui raconte le blues, B.B. King, la légende de Robert Johnson, Muddy Waters. Elle l’écoute, avec passion d’abord. Mais ça ne dure pas. Et puis, il a ses crises de migraine qui les coupent l’un de l’autre. Au fond, elle s’en fout du blues des autres. Elle a assez à faire avec le sien.
C’est Caldwell qui l’attire, ses romans, son sud si éloigné de celui de Faulkner, « ce raciste sournois ». Quant aux autres, et son père surtout, « qu'ils aillent se faire friller le cul par le diable ».
Elle ne saura jamais ce qu’il y avait dans l’étui à violon.

Il faudrait lire ce court roman en écoutant les blues cités au début de chaque chapitre. Mais la musique tourmentée des mots d’Embareck se suffit à elle-même pour nous mettre dans l’ambiance, entre résignation et révolte. « La colère, écrit-il, est la bonne humeur de la tristesse »
***
(Lire dans ce blog d'autres articles de Chantal Lévêque et Bernard Revel consacrés aux livres de Michel Embareck et de Didier Pobel).
***
***
« Tous les chagrins porteurs de lance », de Didier Pobel
(107 pages, éditions Le temps qu’il fait)
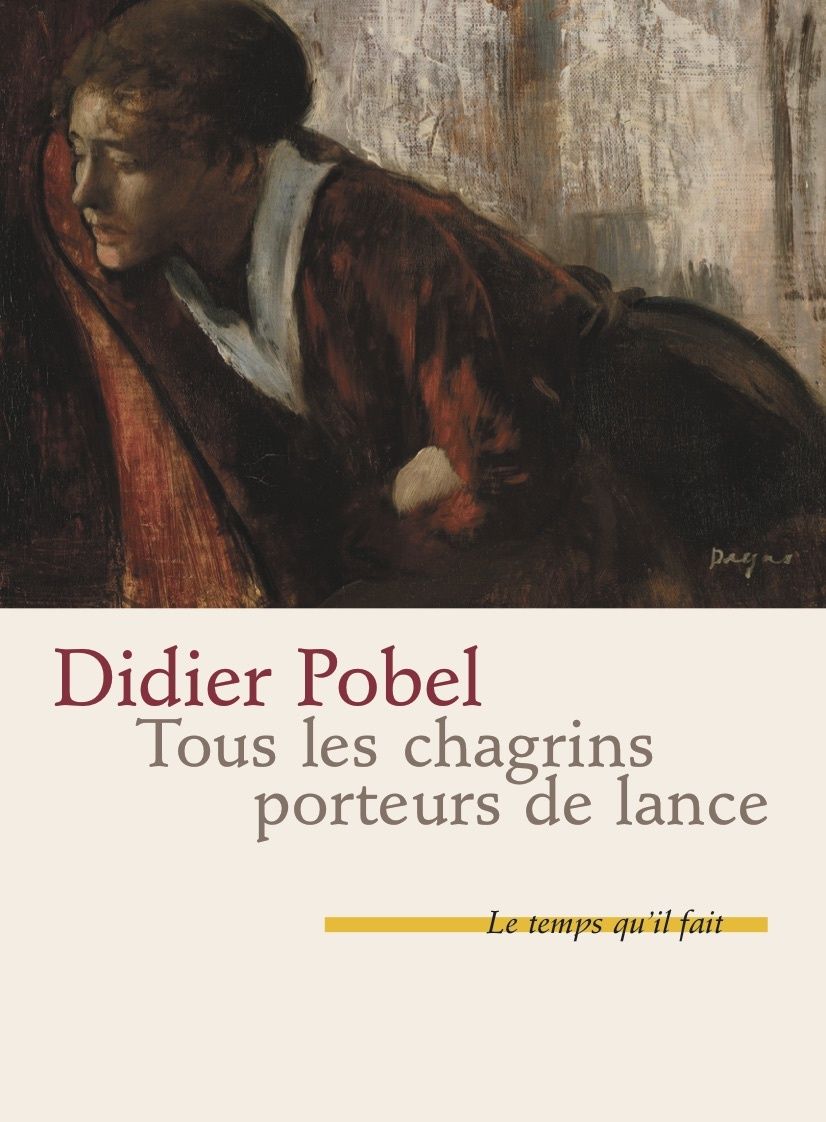
Avec Didier Pobel, c’est une autre chanson. Une chanson douce et triste. Une sorte de blues à la française, plus proche de Françoise Hardy que de Billie Holiday. Le titre d’un tube des années 60 inaugure cette série de dix-neuf nouvelles tournées vers le passé souvent, frappées parfois au sceau poignant du « vécu », comme le souvenir d’un copain d’enfance qui regardait trop passer la micheline, la mort d’un père, les non-dits d’un couple, l’entrée au Lycée « semblables à des clandestins », les confidences inattendues d’un ami. Des phrases de rien du tout - « les mots des pauvres gens » chantait Léo Ferré - comme « on en reparlera », « on continue », « j’espère qu’on n’a rien oublié », « va te regarder dans une glace », meurent en « bulles de silence » ou résonnent à jamais comme un « vieil instant présent ». A moins qu’elles ne préparent, lorsque l’imagination s’en mêle, l’irruption soudaine du fantastique dans la banalité des jours.
L’humour trouve toujours sa place dans les écrits de Didier Pobel, même s’il agit ici en mode mineur, simple moyen de passer à autre chose, d’oublier un moment « ce que nous sommes, nous autres qui ne savons même pas de quoi est fait ce que nous ne saurons jamais de l’autre, ce que nous ne saurons jamais de nous-mêmes ».

La lance de ces chagrins qui s’appellent absence dans le poème d’Armen Lubin d’où est extrait le titre, nous touche au plus profond. Elle traverse un paysage où se côtoient un film de Rohmer, un transistor, une chanson de Jeanne Moreau, une Aronde, Salut les copains, une boite de Zan, Charles Juliet, Henri Calet, André Dhôtel, Jacques Bertin, tous composant un inventaire à la Pobel qui pourrait être le nôtre.
Bernard Revel
(Photos Jean-Christophe Carle)

/image%2F0279781%2F201304%2Fob_516d4f42ac54bcb3a775f2df86d489cc_vl-2009-bon.jpg)