Henri Lhéritier : requiem pour la jeunesse
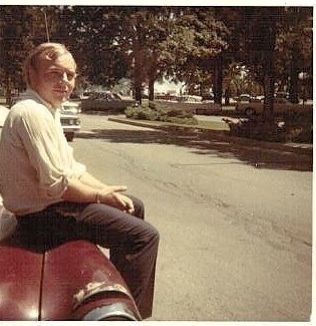
Membre du jury des Vendanges littéraires, Henri Lhéritier est l'auteur, depuis 1999, de "Crest et Romani", "Agly", "De singuliers bourgeois", "Autoportrait sauvé par le vent", "Le défilé du Condottiere". En 2013, paraît "Moi et Diderot (et Sophie)", et en 2015 "Les Vêpres siciliennes".
(Editions Trabucaire, 2011, 262 pages, 15 euros)
Il ne faut pas prendre les écrivains au mot. Même quand ils disent « je », tout ce qu’ils racontent, ils ne l’ont pas vécu. Le « je » des romans, c’est le narrateur. Nuance. Mais qui est au juste ce narrateur, sinon un personnage dans lequel l’auteur met une part plus ou moins grande de lui même ? Car il peut tout se permettre, l’auteur, même de dire la vérité.

Prenez Henri Lhéritier. Dès l’exergue de son nouveau roman « Requiem pour Mignon », parodiant Boris Vian il annonce la couleur : « Tout est vrai, c’est un roman ». Nous voilà bien avancés. Au fond, que cela soit vrai ou non, on s’en fiche un peu, n’est-ce pas, pourvu que cela sonne vrai. Les romans d’Henri Lhéritier ont toujours sonné vrai, jusque dans les délires qui maintenaient cependant une bonne distance entre l’auteur et ses personnages. Mais avec celui-ci, on retombe sur terre. La distance s’efface. On est, on croit être dans la réalité. Du coup, même si la verve comique garde sa vigueur, c’est surtout le piège de l’émotion qui se referme sur nous. Ce n’est pas pour rien que cela s’appelle « requiem ».
Une chose est certaine : Henri Lhéritier a fait un voyage en Amérique dans les années soixante quand il était étudiant. Je n’en sais pas plus. Quarante ans après, il refait le voyage par l’écriture. Il devient « je », le narrateur, celui d’alors et celui d’aujourd’hui, et c’est fou comme ce double « je » lui ressemble. Voilà donc un garçon d’à peine 20 ans, qui vient de quitter son Roussillon natal et se retrouve, avec son copain de fac Enzo, quelque part dans une petite communauté italienne de l’Ontario. Ils se joignent à une équipe d’indiens pour peindre des chalets. D’entrée, une certaine dérision dans le style nous prévient que tout va aller de travers. Et en effet. Le séjour canadien se termine, si j’ose dire, en débandade. Les Italiens auraient dû se douter qu’il est risqué d’aller se saouler toute la nuit de « grappa » extraite de cocottes-minute, en laissant épouses et filles au lit, à la merci de deux jeunes Français qui ne pensent qu’à « ça ». Si le narrateur, qui avoue n’être pas « un homme de décisions héroïques », fantasme plus qu’il n’agit, comme on le vérifiera tout au long du récit, c’est plutôt l’inverse pour son copain. D’où leur départ précipité au volant d’une antique Pontiac achetée avec le maigre fruit de leur labeur. En route vers le Mississippi.
Ce « road-roman » à la sauce Lhéritier n’a rien à voir, on s’en doute, avec le guide du routard. Ni avec Kerouac d’ailleurs. Virtuose de la digression et de phrases qui partent dans tous les sens si bien qu’il se demande lui-même ce qu’il a voulu dire, Henri Lhéritier trouve dans l’Amérique un champ infini de possibles. Mais tout cela n’est que prétexte à noyer le poisson -on a droit, du reste, à la noyade presque réussie du narrateur- ou plutôt à tourner autour du pot. On le pressent au fil des confidences qui se précisent à mesure qu’avance le récit. « Ecrire, c’est être impudique », avoue-t-il. Plus loin : « Je me livre à un exercice de vérité. » Et plus loin encore : « Cette narration m’est de plus en plus douloureuse ». Sous la verve gaillarde, les fêlures apparaissent.
Comme toujours, ça commence bien. La Pontiac échoue à Old Kentucky city, parc d’attraction reconstituant un village de cow-boys. Les deux Français y trouvent un job parmi de nombreux étudiants et coulent des jours tranquilles. Cela nous vaut de savoureuses scènes chez des bourgeois vulgaires, à la plage de « High Riverside » ou au bal du saloon. Le narrateur se lie d’amitié avec Addison, un étudiant en qui il reconnaît un frère, tant il lui ressemble. Tout va pour le mieux dans le meilleur des westerns possibles. Mais on sait que cela ne va pas durer. Le « drame » guette. Qu’est-ce qui peut bien provoquer un drame chez un Français obsédé par les culottes des filles ? L’amour, bien sûr. L’amour a le visage de Bianca. En la voyant, « j’eus le sentiment d’une apparition », dit le jeune homme. « Le monde n’est plus jamais le même lorsqu’on a fait de telles rencontres », dit-il encore. Bianca est belle, inaccessible, parfaite, à une exception près : son écrivain français préféré est Hector Malot. Comment conquérir cette merveille quand on sait qu’on est « du côté des perdants » ? Un tel bonheur semble interdit au narrateur. Et pourtant, l’impossible, le fantasmé, devient réalité. Une réalité qui transforme vite, hélas, le bonheur en fiasco. « J’entame le versant sombre de ma confession, écrit-il, le récit de cet épisode auquel je ne peux échapper, qui a inscrit une marque définitive dans ma jeunesse et dans ma vie tout court ».
Nous n’en dirons pas davantage, sauf que c’est à Gérone que se dénoue le drame laissant le narrateur « foudroyé ». On referme le livre, le cœur serré après avoir tant ri. Pour finir le voyage, il nous reste à écouter la cantate que Schumann composa à la mémoire d’un personnage de Goethe. Subtil hommage de la réalité à la fiction, le « Requiem pour Mignon » sonne dans ce roman comme un adieu nostalgique à la jeunesse et un clin d’œil à la littérature.
Bernard Revel

/image%2F0279781%2F201304%2Fob_516d4f42ac54bcb3a775f2df86d489cc_vl-2009-bon.jpg)
/image%2F0279781%2F20240503%2Fob_cfc416_portrait-thierry-grillet.jpg)
/image%2F0279781%2F20240422%2Fob_7125e1_salman-1.jpeg)
/image%2F0279781%2F20240406%2Fob_b56253_biosca-1.jpeg)
/image%2F0279781%2F20240320%2Fob_e1c081_ph-salus.JPG)